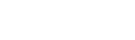L’esprit de collaboration figure parmi les cinq valeurs de la Vision stratégique de l’Hôpital du Valais. Ce dernier s’engage ainsi dans une dynamique relationnelle collaborative et concertée avec les autres professionnels, les patients et leurs proches afin d’assurer la bonne convergence de leurs actes vers un itinéraire thérapeutique cohérent. Entretien avec Eric Bonvin, directeur général de l’institution, au sujet de cette promesse de culture collaborative.
Qu’entend-on exactement par « culture collaborative » ?
Cela peut paraître évident d’écouter le patient, non ? On peut dire d’emblée que s’il y a une mesure qui peut être prise pour améliorer à la fois la qualité et l’efficacité de traitement pour le patient, la santé au travail pour les soignants, ainsi que l’économicité, sans investissement important, c’est la pratique collaborative. Voilà, c’est la recette miracle (rire).
Plus sérieusement, quand on parle de pratique collaborative, on évoque d’abord le partenariat entre les professionnels, mais en incluant le patient. Ce dernier doit être inclus, car il est le seul à pouvoir vraiment dire si un traitement lui convient ou non. On ne peut pas juste le vérifier sur une radiographie… Cela permet de vérifier l’action sur la maladie, mais le seul qui peut nous dire si cela lui convient ou non, c’est vraiment le patient.
Un traitement va convenir au patient s’il arrive à « faire avec » les traitements qu’on lui propose, avec sa maladie. Et « faire avec » signifie être d’accord, éprouver du soulagement. Ces choses-là ne sont pas mesurables, car elles sont uniquement perçues, éprouvées, senties. Et cela, il n’y a que le patient qui puisse le dire. Si l’on oublie cette dimension-là, le soin n’est pas efficace.
On peut, techniquement, réaliser un soin de manière parfaite. On peut réparer une maladie. Mais si le patient n’éprouve pas de soulagement, s’il ne se sent pas bien avec ce soin, le traitement ne sera pas efficace.
Nous vivons une époque où tout doit être mesurable et n’est d’ailleurs payé que ce qui est mesurable. Comment intégrer davantage de collaboration dans un tel système ? Je dirais qu’il y a deux malentendus qu’il faut lever. Le premier est celui de la qualité, qui a deux définitions dans notre monde moderne. D’abord la définition traditionnelle, qui est justement ce qui ne se mesure pas. C’est quelque chose qui est ressenti, éprouvé, et qui ne se mesure pas. Mais ce n’est pas la définition utilisée dans le langage médical aujourd’hui.
Aujourd’hui, on utilise une autre définition de la qualité, qui vient de l’industrie. Et cette définition-là, c’est le critère ou la mesure de la bonne facture d’un produit : « Je prends un objet puis regarde s’il est bien fait ». Et ça, c’est le terme « qualité » auquel on pense quand on parle de labels et autres critères de qualité.
« Par “qualité”, le patient entend la dimension non mesurable et subjective. Tandis que les professionnels en face parlent toujours de la qualité mesurée. »
Nous avons donc là un grand malentendu. Quand la population de patients parle de qualité, elle évoque la qualité relationnelle, son ressenti, la manière dont elle a été reçue… Et quand le patient vit l’expérience du traitement de la maladie et qu’il entend « qualité », il entend la dimension non mesurable et subjective. Tandis que les professionnels en face parlent toujours de la qualité mesurée.
Les deux notions ne sont pas incompatibles, mais il faut aujourd’hui qu’elles se rejoignent: il faut de la qualité humaine et de la qualité « industrielle ».
Et le deuxième malentendu ?
C’est celui de l’efficacité. Quand on parle d’efficacité d’un traitement, on l’a toujours vérifiée sur une maladie : on prend le témoin d’une maladie, par exemple des cellules, et on va vérifier si le traitement, médicamenteux ou autre, agit sur ces cellules-là. C’est de cette efficacité que l’on parle toujours. Mais on ne parle jamais de l’effet sur le malade. Du reste, on dit souvent « ça, c’est du placebo » et on le met de côté. Et là, de la même manière, je pense que ce n’est pas incompatible. Cela doit être complémentaire. On doit avoir une efficacité sur la maladie, mais aussi un effet positif et de soulagement, une efficacité, sur le malade lui-même. Il s’agit en fait de mettre les choses ensemble.
Il faudrait donc mieux prendre en compte la subjectivité du patient…
Oui, car la médecine actuelle a permis et permet toujours de faire beaucoup de choses en étant d’abord rationnelle. C’est-à-dire en rendant les choses intelligibles afin d’agir dessus. On est là dans le réductionnisme et on sépare tout dans le détail. On casse les choses pour aller à l’intérieur, voir ce qui se passe. Prenons l’exemple de la radiothérapie, qui agit de manière extrêmement précise sur les cellules. C’est très intéressant. Mais cela se fait toujours en excluant l’ensemble et le porteur de la maladie. Le rationalisme et le réductionnisme excluent par définition le contexte et la subjectivité du patient. Encore une fois, il ne faut aujourd’hui pas jeter le rationalisme, mais l’élargir. C’est pour ça que je dis qu’il faut arriver à une médecine avec placebo.
Vous dites qu’il faut « élargir le rationalisme ». De quelle manière ?
Justement par une approche dite « collaborative », qui inclut le patient comme être vivant, comme partenaire. Le patient n’est pas juste le porteur d’une maladie, il est aussi celui qui éprouve la maladie. Et si le patient est impliqué dans ce qui lui arrive, dans son ressenti d’être malade et traité, il va aussi faire sa part. Sa part, qui est très importante, c’est de se sentir mieux, de faire en sorte d’aller mieux, d’obtenir cette efficacité-là. Cela, il n’y a que le patient qui puisse le faire. Il faut donc l’entendre, qu’il puisse être autour de la table et faire partie du traitement. Il ne peut pas juste dire, « voilà, moi je vous donne ma maladie, débrouillez-vous avec ça ! »
« La culture collaborative propose de
passer d’un mode de travail dans la
compétition, dans la lutte les uns contre
les autres, vers une dynamique de
collaboration avec le patient. »
Cela pourrait être plus confortable pour le patient, non ? De s’en remettre aux spécialistes…
On peut en effet se dire que c’est plus confortable, d’une certaine manière. Mais pour autant que ce soit clair. Le patient sera d’accord s’il est vraiment en confiance et convaincu qu’il va gagner en soulagement. Le patient est tout de même la personne qui autorise le soin. On ne peut pas soigner quelqu’un contre son gré, à son insu. Il doit donc accepter, dire, « OK, je suis en confiance avec vous ». Il est très important d’obtenir cette confiance, parce que le patient « se donne » en quelque sorte. Et cette confiance, il faut la gagner. Quand on parle de collaboration, il s’agit donc d’intégrer cette dimension subjective, ce que ressent le patient, sa manière d’être…
Pourtant, cette collaboration semble parfois faire défaut…
C’est vrai, cette culture de la collaboration n’est pas facile à mettre en place, parce que tout notre système est fondé sur autre chose. Il est fondé sur la concurrence et la compétition. Aujourd’hui nous sommes dans un système de marché où l’on pense qu’en améliorant la qualité, on améliore l’efficacité, dans la compétition. Et c’est quelque chose qui ne fonctionne pas.
Pourquoi cette compétition ne fonctionne-t-elle pas ?
Prenons l’exemple d’un bloc opératoire : si les gens sont en compétition, ils ne vont pas se parler ni échanger d’informations importantes. S’il y a des conflits ou de la compétition entre les équipes qui prennent en charge un patient, certaines informations vont être perdues. Le patient, lui, ne sait pas où il se situe et sa prise en charge est morcelée. La compétition est un poison dans notre système, qui enlève la transparence nécessaire et nuit à la sécurité des patients et à la qualité globale de la prise en charge. C’est un vrai problème, mais cela représente la culture de base dans laquelle nous évoluons.
La culture collaborative propose justement d’inverser cela. C’est-à-dire de passer d’un mode de travail dans la compétition, dans la lutte les uns contre les autres, vers une dynamique de collaboration avec le patient.
Cette compétition n’est-elle pas aussi et peut-être surtout une compétition par équipes, entre institutions ?
Absolument, elle se situe à tous les échelons. De plus, cette compétition au niveau des institutions induit la mesure de la production de prestations. Aujourd’hui, on estime qu’une intervention sur cinq, une prestation sur cinq, est inutile. On la réalise parce qu’il faut être productif et concurrentiel, mais si elle est inutile, c’est qu’elle est nuisible pour le patient. Si je me fais ouvrir le ventre inutilement, ce n’est tout de même pas terrible-terrible… C’est un énorme problème à tous les échelons.
Autre problème, ce système rend aussi le climat de travail difficile et les gens déplorent souvent une perte de sens. Si l’on travaille juste pour « produire de la prestation » et rester concurrentiel, c’est difficile à vivre. Cela instaure surtout une forme de rivalité permanente et un climat qui épuise les gens. Aujourd’hui nous avons un vrai problème avec cela. Les gens sont épuisés.
Les gens souffrent aussi d’un sentiment de contrôle permanent ?
Oui. On a par exemple pu le voir durant la période du Covid-19, même si on le savait déjà : les équipes qui ont intégré une approche collaborative ont nettement moins le sentiment d’être épuisées que celles où le climat est plus tendu et qui sont sous pression.
Quelles sont les solutions pour induire ce changement vers davantage de collaborations ?
C’est un changement qui ne coûte pas grand-chose et qui est à disposition chacun. Mais il est probablement difficile à mettre en place, car c’est une question de culture. Cela prend donc du temps. À l’Hôpital de Valais, cela fait une dizaine d’années que nous y travaillons. Ça rentre, petit à petit, mais il faut aller encore un peu plus loin dans cette voie.
L’Hôpital du Valais ne peut pas non plus travailler seul à ce changement de culture…
Non, bien sûr, et cette question a aussi déjà été évoquée au niveau national. Cela fait une dizaine d’années que les hautes écoles et les universités disent qu’il faut passer à l’interprofessionnalité. C’est-à-dire apprendre aux différentes professions à travailler ensemble. Et si ce n’est pas gagné, nous avons aujourd’hui une première génération d’étudiantes et d’étudiants qui ont déjà été sensibilisés à cette interprofessionalité.
« Une machine peut réparer quelque chose, mais elle ne peut pas soulager un
patient. Pour soulager un patient, il faut un autre être humain. »
Ce qui est prévu et espéré, c’est que ces étudiantes et étudiants passent à la dernière phase du processus, la dimension collaborative incluant le patient, lorsqu’ils entament leur carrière professionnelle. Le but recherché au niveau suisse est donc de sensibiliser les professionnels à une nécessaire collaboration, puis d’intégrer le patient comme partenaire lorsqu’ils débutent dans l’activité clinique.
Les institutions doivent aussi travailler à ce changement de culture. Notre rôle à l’Hôpital du Valais est de saisir cette opportunité et d’assembler les différents maillons de la chaîne. Je suis convaincu de l’apport énorme de cette approche au niveau de l’institution et c’est pour cela que nous avons placé « l’esprit de collaboration » comme l’une des valeurs cardinales de l’Hôpital du Valais.
Cette intégration grandissante des patients commence à se voir et à se sentir au sein de l’Hôpital du Valais, notamment par le biais d’associations de patients. Mais certains professionnels peuvent avoir l’impression de perdre un peu de pouvoir, à l’image du curé du village, du « régent » et du président de commune à l’époque ?
Oui, c’est vrai. C’étaient des gens qui disposaient du savoir et qui avaient le pouvoir. Mais aujourd’hui, ils n’ont plus ce savoir. C’est aussi un enjeu important. Aujourd’hui, on ne va plus chez un professionnel en disant « je vais chez lui parce que c’est le seul qui sait ». En général on en sait davantage que lui. Et avec Chat GPT, c’est encore pire… La valeur du professionnel ne réside donc plus, ou pas seulement, dans le savoir.
Ce qui est aujourd’hui important dans la rencontre avec un professionnel, c’est justement la valeur humaine. C’est pour cela que la qualité humaine, l’efficacité humaine, devient essentielle. Sinon, le reste, les machines peuvent le faire. Mais une machine ne peut pas soulager un patient. Elle peut réparer quelque chose, mais elle ne peut pas soulager un patient. Pour soulager un patient, il faut un autre être humain. Et cela, c’est ce que tous les soignants, y compris les médecins, peuvent faire.
Donc tout n’est pas aussi « mécanique » que ce que l’on pense dans le corps humain ?
C’est effectivement une autre forme de malentendu. Depuis les XVIe-XVIIe siècles, on est parti de l’idée que les maladies étaient la cause des souffrances des humains. En éradiquant les maladies, ce qui est le projet de l’OMS, on pensait éliminer les souffrances. En disant « la santé, c’est l’absence de maladie », on s’est lancé dans un grand projet d’éradication des maladies. On voit que cela ne fonctionne pas tout à fait… Ceci dit, c’est bien de s’occuper des maladies et cette médecine fait de très bonnes choses sur les maladies. Mais elle arrive par contre à un stade un peu contre-productif où elle produit pratiquement autant de maladies qu’elle en soigne.
Photo : © Sedrik Nemeth