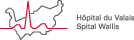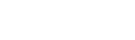La sclérose en plaques (SEP) est une maladie chronique du système nerveux central qui affecte le cerveau et la moelle épinière. Bien que les causes exactes de cette maladie demeurent mal comprises, les progrès médicaux ont permis d’améliorer la gestion de la SEP et de mieux cerner ses effets. Les troubles neurologiques, souvent invisibles, ont pourtant un impact majeur sur la vie quotidienne des patients. Explications de la Dre Sonia Kirchner, neurologue à l’Hôpital du Valais, site de Sion.
Des symptômes invisibles mais qui impactent la qualité de vie
L’un des aspects les plus difficiles de la SEP réside dans la diversité et l’invisibilité de certains de ses symptômes. Parmi les plus fréquents, la fatigue est particulièrement invalidante. Elle n’est pas simplement un manque d’énergie temporaire : elle peut devenir un fardeau quotidien, empêchant les patients de mener une vie normale. La fatigue liée à la SEP est d’autant plus complexe à diagnostiquer qu’elle ne se manifeste pas toujours de manière évidente et peut être négligée lors de l’évaluation des symptômes.
D’autres troubles, comme les problèmes de motricité, les troubles cognitifs (troubles de concentration et de l’attention) et les troubles de la vision, sont également fréquents. Si certains symptômes comme les difficultés de déplacement peuvent être visibles, d’autres, comme les troubles cognitifs, les troubles sensitifs ou la douleur, sont invisibles aux yeux des autres, ce qui peut rendre difficile la compréhension de la maladie par l’entourage et limiter les contacts sociaux des patients.
La sclérose en plaques : une maladie auto-immune et inflammatoire
La SEP est une maladie inflammatoire auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire attaque par erreur les cellules du système nerveux central, en particulier la myéline, une substance qui protège les fibres nerveuses. Cela conduit à une inflammation et à des lésions qui perturbent la transmission des signaux nerveux. Cette altération de la fonction nerveuse provoque les symptômes variés de la SEP.

Bien que la cause exacte reste encore floue, plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’apparition de la maladie. Les femmes sont plus touchées que les hommes, et les personnes d’origine européenne ont également un risque plus élevé. Des facteurs environnementaux tels qu’un faible taux de vitamine D, le tabagisme, et des infections virales, notamment le virus Epstein-Barr, sont aussi souvent cités parmi les facteurs de risque, bien qu’ils ne soient pas des causes directes de la SEP.
Un diagnostic parfois difficile à établir
Le diagnostic de la SEP est complexe et repose sur une combinaison de critères cliniques, radiologiques et biologiques. L’examen clinique permet d’objectiver les symptômes et de poser une première suspicion de la maladie. L’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) est ensuite utilisée pour détecter les lésions caractéristiques de la SEP sur le cerveau et la moelle épinière.
Cependant, il existe des situations où l’IRM, qui est réalisée pour d’autres indications, révèle des lésions sans que les symptômes soient présents, ce qui est connu sous le nom de « syndrome radiologique isolé ». Dans ce cas, un suivi régulier est nécessaire pour détecter l’apparition éventuelle de nouvelles lésions. Parfois, une ponction lombaire (prélèvement de liquide céphalorachidien) peut être réalisée pour rechercher des marqueurs d’inflammation caractéristiques de la SEP, bien que cette procédure soit souvent redoutée par les patients.
La ponction lombaire : une procédure moins effrayante qu’elle n’y paraît
Souvent perçue comme un acte médical douloureux, la ponction lombaire est en réalité bien moins invasive et douloureuse que ce que beaucoup imaginent. Cette procédure consiste à prélever un échantillon de liquide céphalorachidien afin d’analyser les signes d’inflammation dans le système nerveux central. Les aiguilles utilisées de nos jours sont très fines, et la douleur ressentie est généralement légère, voire presque inexistante. De plus, les risques associés à cet examen sont faibles.
Les traitements de la sclérose en plaques : gestion des poussées et des symptômes
Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif pour la sclérose en plaques, mais des médicaments permettent de mieux contrôler la progression de la maladie et d’atténuer les symptômes. Lors d’une poussée, des traitements de crise, tels que des perfusions ou des comprimés, sont souvent prescrits pour accélérer la récupération après une poussée. Ces traitements sont efficaces pour gérer les symptômes aigus, mais ils n’ont pas d’effet sur l’évolution à long terme de la maladie.
Les traitements de fond, en revanche, visent à ralentir l’évolution de la SEP en réduisant la fréquence et l’intensité des poussées. Certains médicaments, ayant des mécanismes d’action immunomodulateurs et/ou immunosupresseurs, peuvent être envisagés de manière personnalisée en fonction de leur efficacité, des risques associés et de l’impact sur la qualité de vie. Ces traitements aident à limiter la charge lésionnelle, c’est-à-dire les lésions dans le système nerveux central, contribuant ainsi à ralentir l’évolution de la maladie. Avec un traitement adapté, on peut bloquer complètement l’évolution de la maladie.
Des options thérapeutiques plus ciblées en développement
Si les traitements actuels permettent de mieux contrôler la maladie, de nouvelles thérapies plus ciblées sont en cours de développement. Ces traitements visent à améliorer l’efficacité et diminuer les effets indésirables. De nombreuses études sont également en cours pour mieux comprendre les causes de la maladie et pour tester de nouvelles approches thérapeutiques.
Dans les situations nécessitant des traitements immunosuppresseurs, des contrôles réguliers sont mis en place afin de mieux gérer les risques infectieux.
Une prise en charge globale et personnalisée
La gestion de la SEP ne se limite pas aux médicaments. Elle inclut également une approche personnalisée visant à améliorer la qualité de vie du patient. L’exercice physique, par exemple, joue un rôle important dans le maintien de la fonction physique et cognitive. Il est essentiel que les patients adaptent l’intensité et la fréquence de leur activité en fonction de leur état, afin de ne pas exacerber les symptômes de fatigue.
La gestion de la fatigue est également primordiale, car elle touche presque tous les patients atteints de SEP. Les périodes de repos sont nécessaires pour préserver l’énergie des cellules nerveuses et musculaires. Le soutien psychologique, l’adaptation de l’environnement de travail, et la gestion du stress sont également des éléments essentiels du traitement.
Espérance de vie et qualité de vie
Bien que la sclérose en plaques soit une maladie incurable, elle n’affecte pas nécessairement l’espérance de vie. En effet, grâce aux traitements actuels, la mortalité liée à la SEP reste faible et proportionnelle à la sévérité de la maladie. Toutefois, la qualité de vie peut être affectée par des symptômes chroniques tels que les troubles de la marche, le manque de force, parfois des troubles vésico sphinctériens, la fatigue, la douleur ou les troubles cognitifs. Il est donc crucial que les patients bénéficient d’une prise en charge précoce et adaptée pour préserver leur autonomie et leur bien-être.
Conseils pour les personnes récemment diagnostiquées
Si vous venez d’être diagnostiqué avec la sclérose en plaques, il est important de ne pas vous laisser décourager. Discutez avec votre médecin des options thérapeutiques adaptées à votre situation. Un suivi médical régulier permettra de suivre l’évolution de la maladie et d’adapter le traitement en fonction des besoins.
Il est aussi recommandé de rester actif et de pratiquer une activité physique régulière en augmentant l’intensité progressivement, tout en respectant les périodes de repos. L’accompagnement par un psychologue et des groupes de soutien peut également être bénéfique pour mieux gérer les aspects émotionnels de la maladie. Selon les symptômes, parfois un traitement régulier en physiothérapie et/ou ergothérapie est recommandé, ainsi qu’un bilan neuropsychologique de contrôle en cas d’aggravation des symptômes comme la fatigue ou les troubles cognitifs.
Découvrez le témoignage de Mme Sabine Muster, membre du groupe régional du Valais « Les Battants », en vidéo :
Liens utiles:
Valais «Les Battants» | Société suisse de la SEP
Flyer du Groupe régional SEP Valais les Battants